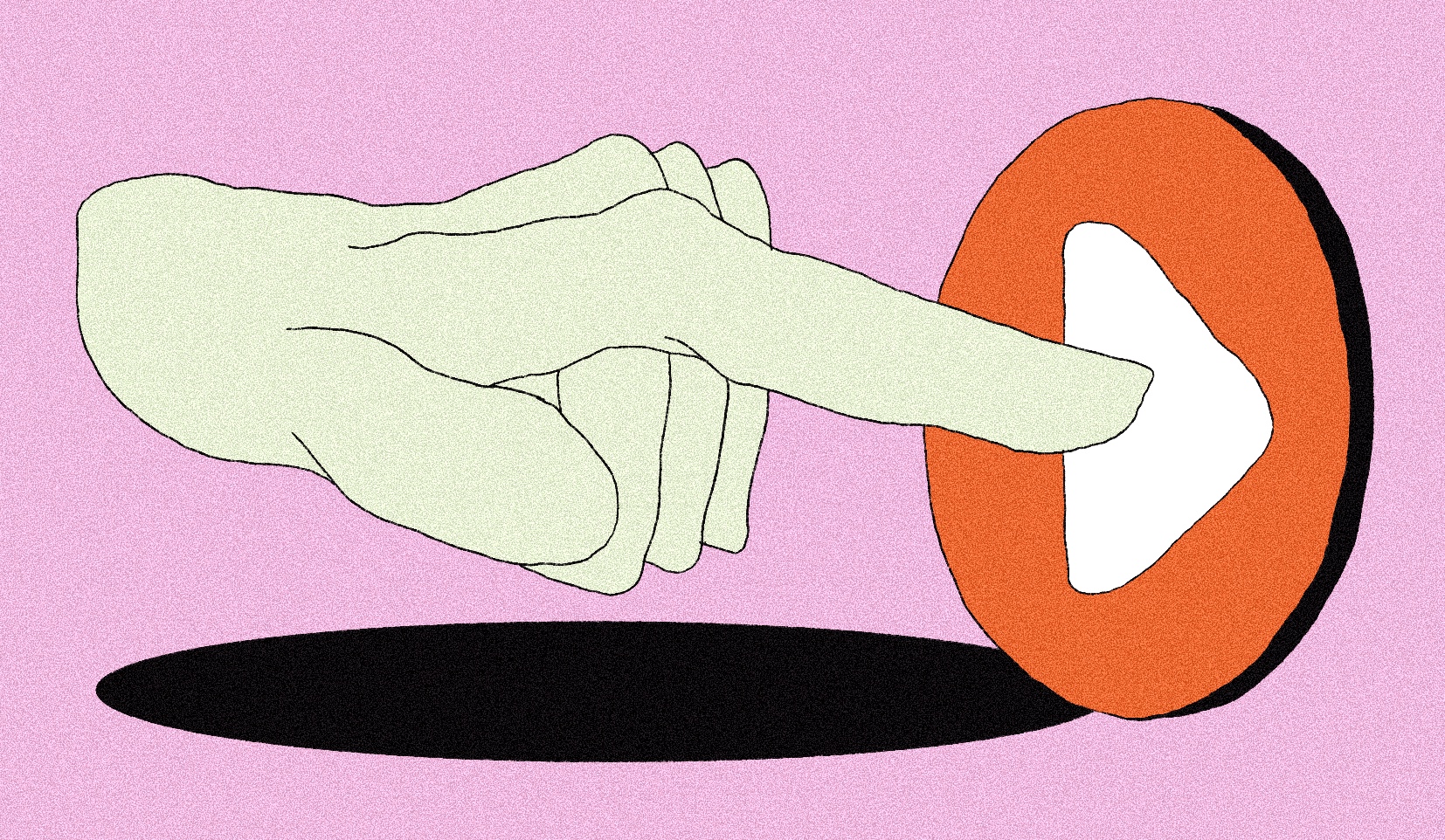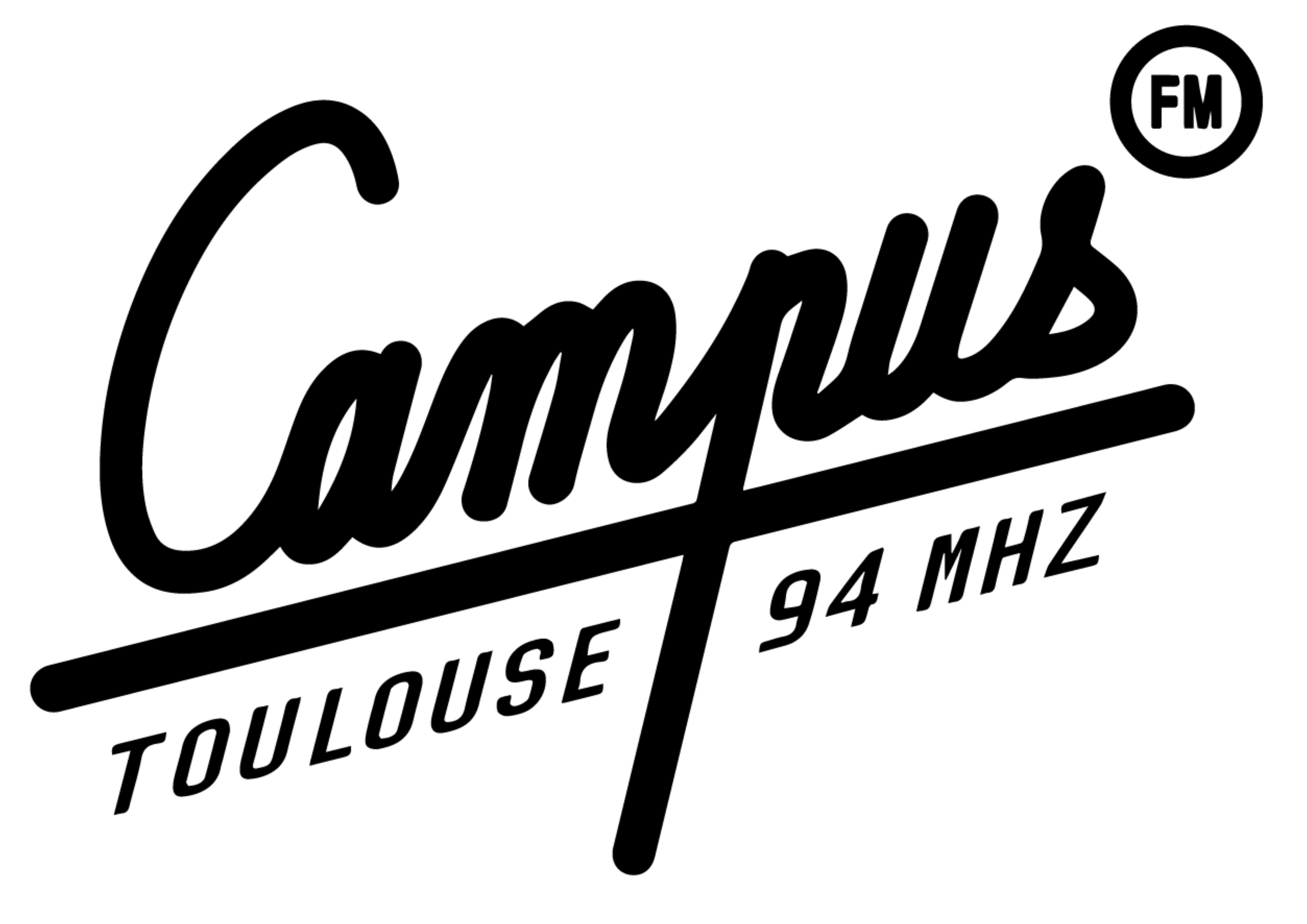Perfect Blue, de cette relation si particulière au corps
Il y a des œuvres qui grandissent avec le temps, qui de par un processus de maturité s’ouvrent et nous donnent à voir une lecture approfondie d’elles-mêmes mais aussi et surtout de notre environnement présent. Œuvre éminent visionnaire sur nos maux actuels, Perfect Blue laisse également lors du premier visionnage un sentiment amer comme si l’on avait manqué l’essentiel… L’on pourrait presque alors débuter en invoquant les théories de l’esthétisme romantique, où l’exercice critique se devait de débarrasser l’œuvre de la gangue de l’agréable pour atteindre cette partie cachée, ce noyau prosaïque qu’était la teneur en vérité de l’œuvre, signant ainsi son parachèvement, sa dissolution complète dans une forme d’art absolue. Peut-être faut-il en passer par là avec le premier film de Satoshi Kon, par l’exercice critique au risque de retomber un peu blafard voir pataud dans ce qu’appelait le philosophe Walter Benjamin en son temps le simple commentaire, manquant ainsi tout l’objet de la démarche initiale… Il faut dire que l’on ne fait pas ici figure de pionnier dans cette tentative de démystification, d’autres avant nous ont creusé un sillon profond. D’autres avant nous ont remarqué le caractère profondément illuminé de ce thriller inclassable qui en disait déjà long sur notre rapport à l’image et la virtualisation de nos rapports sociaux…
Il est vrai qu’en 1997 à la veille de l’explosion de la bulle internet française, Satoshi Kon pas encore tout à fait sorti des jupes du réalisateur Katsuhiro Otomo s’adonnait à la direction de son premier long métrage, cette fois seul aux manettes de ce qui allait devenir une œuvre culte du cinéma d’animation japonais… Le film nous dévoile l’histoire de la jeune Mima, chef de file d’un groupe d’Idols bien calibré et qui décide sous les conseils plus ou moins avisés de son manager de couper court à la chansonnette afin de poursuivre une carrière d’actrice. Ce qu’elle ne pressent pas immédiatement dirons-nous c’est la frustration générée par un tel revirement auprès de ces fans les plus dédiés. Surtout qu’une suite de morts violentes commence à se propager dans l’entourage proche de la jeune adolescente…
Ce qui pourrait constituer ici une intrigue somme toute classique, presque éreintée du dévot ayant quelque peu perdu la raison, se transforme très vite en un jeu subtil que Satoshi Kon mène à la fois avec ses personnages, mais avant tout et surtout avec le spectateur lui-même. En effet, dès la scène d’ouverture du film, Satoshi Kon vient jouer avec nos perceptions et nos sens, si bien que l’on en vient très vite à se demander si la scène qui se déroule devant nos yeux est bien réelle ou si l’on est face à une mise en scène voire une chose de l’ordre du rêve, de la fantasmagorie ? Voilà ici précisément l’une des thématiques principales de Perfect Blue, l’un des centres de rotation de l’œuvre, ce rapport à l’image si particulier procurant malaises et sensations vertigineuses durant les presque quatre-vingt-dix minutes de pellicule.
Un nouvel élément qui pourrait venir étayer cette thèse se trouve peut-être dans les derniers dialogues de Paprika, où l’un des protagonistes nous rappelle que « de la fiction nait la réalité ». Peut-être sommes-nous ici en effet avec Perfect Blue dans une sorte de moment dialectique où la fiction s’en trouve dépassée pour accoucher par une négation de la négation dans ce qui constituerait une pure forme de Réalité, une réalité qui tiendrait en somme de l’ordre de l’absolu. Le film va en effet pousser continuellement notre héroïne dans cette torpeur, dans ce questionnement permanent, emportant le spectateur lui aussi dans ce chamboulement du savoir sensible. L’exemple le plus représentatif constitue peut-être le tournage de la scène du viol. Tout est ici, faux, simulé, nous sommes là dans un film dans un film, mais impossible de ne pas être dérangé par le caractère insoutenable de la scène et ce malgré la distance imposée. Là encore, apparait la détresse des protagonistes, Mima elle-même ne sachant plus distinguer le vrai du faux, le moment où commence et où s’arrête le travail d’actrice là ou commence et s’arrête la réalité. Là encore Satoshi Kon par l’habileté de sa mise en scène plonge le spectateur lui-même dans ce chaos sensoriel, nous donnant presque l’impression d’être nous aussi complice de cette violence visuelle, notre poste de télévision n’étant qu’un énième écran face à l’horreur présente.
Cette scène bien plus brutale que n’importe quelles scènes de meurtres présentes dans le film met en avant un autre élément crucial, celui de cette relation si particulière au corps. Tour à tour chanteuse sous la lumière étouffante des projecteurs, tour à tour actrice malmenée dans la moiteur sombre des décors de studios, tour à tour jeune adolescente tokyoïte perdue dans l’immensité de la mégalopole, Mima enchaine sans broncher les figures de style avec pour seul point commun celui du procès d’un corps qui n’est plus vraiment celui d’une enfant pas totalement celui d’une femme mais dont le monde s’est chargé de cette mutation accélérée. Les corps chez Satoshi Kon sont au passage souvent meurtries. L’épiderme, le moindre tissu musculaire semblent comme prêt à rompre sous le moindre effort, la moindre sollicitation. Mima n’échappe pas à cette règle sournoise, et ira jusqu’à constituer elle-même le réceptacle funeste d’une violence débordante sous toutes ses formes. Cette jeune fille donnée en pâture sur tous les moniteurs de retours du studio, interroge et questionne cet acte de mort plus ou moins conscient. Le film de part certain aspects fait donc également écho avec une très grande justesse à des problématiques très actuelles d’exposition sur les réseaux sociaux, ou plus simplement du rapport à la vie privée.
Nous venons de le voir, les embranchements sont donc ici multiples et chaque approche semble déboucher sur un nouveau dédale complexe. L’on se perd alors dans des tentatives hasardeuses d’exégèses plus ou moins réussies, repoussant inlassablement l’objet de notre quête initiale. Difficile également de résumer le film à un genre ou à un propos mais c’est peut-être mieux ainsi. Eviter une trop grande facilité voilà peut-être le propre de l’œuvre de Satoshi Kon. Dissocier l’image d’un signifié trop évident, surmonter le constat positiviste en questionnant le contenu objectif.
De manière plus générale faut-il pour saisir l’œuvre dans son entièreté peut-être chercher une parenté plus ou moins proche. Walter Benjamin évoquait en ses termes la métaphore des sœurs. Il ne faudrait pas selon lui forcer la porte de la belle mystérieuse mais chercher une sœur pour résoudre l’énigme… Il nous faudrait donc étendre le domaine d’étude à l’entièreté du recueil de l’auteur pour y trouver un début de remède au mal qui nous ronge…
La rétrospective proposée à la cinémathèque de Toulouse constitue donc un outil précieux dans cette quête spirituelle. Satochi Kon lui-même semble nous adresser une note d’espoir à la toute fin de son film lorsque Mima, transperçant alors le quatrième mur nous rassure et nous lance un “Je suis la vraie Mima” ultime réappropriation de son identité et peut-être pour la première fois l’assurance de se trouver dans un monde où conscience et vérité sont réconciliées tant dans leurs contenus que dans leurs substances.
Florent Jourde
Pour “Rien à voir, quoique”, émission spéciale en direct et en public
de La Cinémathèque de Toulouse le 27 février 2020, pour le cycle Satoshi Kon.
Cliquez ici, pour écouter la chronique.
Le replay de l’émission